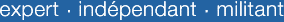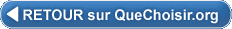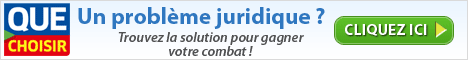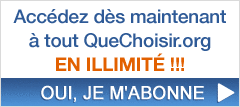Médicaments génériques
-
jlbourghol
- Super Modérateur

- Messages : 274
- Enregistré le : 10 oct. 2011, 13:39
- Contact :
 Médicaments génériques
Médicaments génériques
Les Français font de moins en moins confiance aux médicaments génériques. En pharmacie acceptez-vous facilement un générique à la place d'un médicament de marque ?
Re: Médicaments génériques
jlbourghol a écrit :Les Français font de moins en moins confiance aux médicaments génériques. En pharmacie acceptez-vous facilement un générique à la place d'un médicament de marque ?
C'est la sécu qui paie, et la Sécu c'est nous tous : aussi je me fais un devoir d'accepter la substitution par les génériques, comme si l'argent sortait de ma poche ! Et même si le générique ne contient pas le même excipient peu m'importe pourvu que le principe actif soit le même ... Et ceux à qui la substitution ne convient pas, sont dans leur droit, s'il acceptent de prendre à leur charge l'avance des frais .
 Que faire en cas de litige ?
Que faire en cas de litige ?
-

UFC-Que Choisir
 Que Choisir vous propose également
Que Choisir vous propose également
-

UFC-Que Choisir
Re: Médicaments génériques
Mon état de santé m'oblige à prendre un médicament dont le générique coûte 217 € par mois(et j'en ai pour 5 ans)
Même si le médecin qui me suit m'avais prescrit un médicament non générique ( à 40% plus cher)j'ai tenu à avoir du générique après la question de mon pharmacien.
Les analyses servant à suivre l'évolution de ma maladie,qui donnaient au début des résultats dans les 4/100èmes ,ces derniers sont depuis passés en-dessous du niveau de détection mais ce à l'échelle des 2/1000 èmes.
Et je n'ai consommé que du générique !
Même si le médecin qui me suit m'avais prescrit un médicament non générique ( à 40% plus cher)j'ai tenu à avoir du générique après la question de mon pharmacien.
Les analyses servant à suivre l'évolution de ma maladie,qui donnaient au début des résultats dans les 4/100èmes ,ces derniers sont depuis passés en-dessous du niveau de détection mais ce à l'échelle des 2/1000 èmes.
Et je n'ai consommé que du générique !
Re: Médicaments génériques
L'article paru récemment dans QC concernant les génériques ainsi que certains commentaires m'obligent à réagir: J'ai eu de gros soucis de santé il y a environ 2 ans dont mon médecin ne trouvait pas la cause malgré de nombreux test et analyses, etc...
Au bout de 4 mois, sans aucune amélioration, en recherchant ce qui avait bien pu se passer 4 mois auparavant, nous avons remarqué que le début de mes problèmes coïncidait avec le début de la prise du générique du Lévothyrox. On essaye donc de reprendre le Levothyrox non générique, et là, tout rentre dans l'ordre, mes soucis de santé disparaissent comme par enchantement!
Plus récemment, pour une autre pathologie, mon épouse passe aussi à un médicament générique. quelques jours plus tard, elle est comme paralysée par de violent mal de dos, au point de ne plus pouvoir bouger. On pense d'abord à un refroidissement ou à aller consulter un ostéopathe...Mais, sans m’appesantir sur les détails, là encore on s’aperçoit bien vite que le problème venait du générique. En reprenant le médicament "normal" tout est aussitôt rentré dans l'ordre. Là aussi elle pris du générique sans appréhension, et était loin de se douter que cela pourrait avoir de telles conséquences
Je sais d'avance ce que certains vont dire, que c'est psychologique, etc...mais tant que vous n'avez pas vous même subi ce genre de choses, évitez d'affirmer que tous les génériques sont sans danger!
Probablement que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux médicaments et qu'il y a aussi de bons génériques, mais essayer de culpabiliser les personnes qui pour de bonnes raisons ne prennent plus de génériques, ça a le dont de particulièrement m'énerver, tout juste si on ne nous prend pas pour des débiles mentaux!
Avant d'essayer de culpabiliser les patients, essayez de comprendre pourquoi certains médicaments soit-disant identiques sont mieux tolérés que d'autres...C'est peut-être qu'ils ne sont pas si identiques qu'on nous le dit
Au bout de 4 mois, sans aucune amélioration, en recherchant ce qui avait bien pu se passer 4 mois auparavant, nous avons remarqué que le début de mes problèmes coïncidait avec le début de la prise du générique du Lévothyrox. On essaye donc de reprendre le Levothyrox non générique, et là, tout rentre dans l'ordre, mes soucis de santé disparaissent comme par enchantement!
Plus récemment, pour une autre pathologie, mon épouse passe aussi à un médicament générique. quelques jours plus tard, elle est comme paralysée par de violent mal de dos, au point de ne plus pouvoir bouger. On pense d'abord à un refroidissement ou à aller consulter un ostéopathe...Mais, sans m’appesantir sur les détails, là encore on s’aperçoit bien vite que le problème venait du générique. En reprenant le médicament "normal" tout est aussitôt rentré dans l'ordre. Là aussi elle pris du générique sans appréhension, et était loin de se douter que cela pourrait avoir de telles conséquences
Je sais d'avance ce que certains vont dire, que c'est psychologique, etc...mais tant que vous n'avez pas vous même subi ce genre de choses, évitez d'affirmer que tous les génériques sont sans danger!
Probablement que tout le monde ne réagit pas de la même manière aux médicaments et qu'il y a aussi de bons génériques, mais essayer de culpabiliser les personnes qui pour de bonnes raisons ne prennent plus de génériques, ça a le dont de particulièrement m'énerver, tout juste si on ne nous prend pas pour des débiles mentaux!
Avant d'essayer de culpabiliser les patients, essayez de comprendre pourquoi certains médicaments soit-disant identiques sont mieux tolérés que d'autres...C'est peut-être qu'ils ne sont pas si identiques qu'on nous le dit
Génériques non merci
Alors depuis le temps qu'on nous oblige à utiliser des génériques, il est pas encore comblé le trou de la sécu avec les économies que ça devait engendrer, vous y croyez encore à ce discours  ???
???
Avez-vous fait le test de la différence entre deux factures chez le pharmacien ? moi oui, il y avait moins d'un euro d'écart entre les génériques et les originaux, alors déjà que l'efficacité des médicaments classiques est sérieusement douteuse, quand on sait que dans les génériques on met des tas d’excipients de qualité moindre pour un profit maxi (confidences que m'a fait une visiteuse médicale)...
Et si votre pharmacien met du zèle à vous culpabiliser si vous n'en voulez pas, c'est parce que les labos le rétribuent grassement pour le stock écoulé (avec des boites gratuites pour lui), voilà la boucle est bouclée, pas plus compliqué, on se fait beurre sur votre santé !!!
Si les visiteurs médicaux racontaient un jour ce qu'ils savent...
Avez-vous fait le test de la différence entre deux factures chez le pharmacien ? moi oui, il y avait moins d'un euro d'écart entre les génériques et les originaux, alors déjà que l'efficacité des médicaments classiques est sérieusement douteuse, quand on sait que dans les génériques on met des tas d’excipients de qualité moindre pour un profit maxi (confidences que m'a fait une visiteuse médicale)...
Et si votre pharmacien met du zèle à vous culpabiliser si vous n'en voulez pas, c'est parce que les labos le rétribuent grassement pour le stock écoulé (avec des boites gratuites pour lui), voilà la boucle est bouclée, pas plus compliqué, on se fait beurre sur votre santé !!!
Si les visiteurs médicaux racontaient un jour ce qu'ils savent...
-
odilegirard
- Consom'acteur *

- Messages : 1
- Enregistré le : 14 févr. 2013, 16:19
Re: Médicaments génériques
voir sur le sujet le site du DR. Girard par ex.http://www.rolandsimion.org/spip.php?article205
Les génériques : un cas d’école
Régression préoccupante saluée comme un progrès par tous les pourfendeurs de Big Pharma dont l’assentiment jobard conforte les autorités dans des mesures d’incitation de plus en plus contraignantes, l’avènement des génériques mérite au contraire d’être dénoncé au travers de la grille d’analyse découlant des constats précédents. Car s’il est classique de stigmatiser l’industrie pharmaceutique (et leurs autorités de tutelle) pour les prix exorbitants de leurs pseudo-innovations censément justifiés par un coût de recherche nettement surévalué [10], force est de constater qu’en pharmacie, la fabrication de génériques représente, à l’autre extrême, un moyen facile de faire de l’argent à bas coût, en utilisant - avec la scandaleuse connivence des agences sanitaires - la santé publique comme variable d’ajustement [11].
Si elle en est venue aujourd’hui à concerner à peu près tous les médicaments, il faut bien constater, en effet, que cette dégradation accélérée de la qualité pharmaceutique a été fortement encouragée par la mode des génériques qui ne connaît quasiment d’autre règle que la réduction des coûts - coûte que coûte, si j’ose dire. Et pour maximiser cette réduction (partant, le profit du génériqueur), la délocalisation est une stratégie clé. Le médicament aura, par exemple, été fabriqué au Canada, sur un principe actif produit en Inde à partir de matières premières venus de Chine, l’autorisation de mise sur le marché ayant été finalement octroyée sur la base d’une petite étude de bioéquivalence (cf. plus bas) réalisée en Pologne : ce n’est pas un circuit aussi étourdissant qui empêchera les autorités de rançonner les citoyens français via un remboursement financé par la Sécurité sociale...
A elle seule, cette "étude de bioéquivalence" suffit à caractériser et la mauvaise foi des autorités, et leur criminelle inconscience. Pour faire simple, il s’avère que l’essentiel qui conditionne l’autorisation de mise sur le marché d’un générique est une petite étude généralement réalisée chez une vingtaine de patients qui permet de montrer que les taux sanguins obtenus avec la copie sont "à peu près" les mêmes que ceux obtenus avec le médicament copié (princeps). Par "à peu près", la réglementation entend que la concentration maximale obtenue avec le générique se situe dans une fourchette de ±20% par rapport au princeps (soit, en d’autres termes, dans une zone comprise entre 80% et 120% relativement aux valeurs obtenues avec le médicament princeps).
Imaginons un patient qui reçoit un "générique-80%" et qui ajuste sa posologie avec ce médicament ; imaginons maintenant que lors du renouvellement, il lui soit délivré un "générique-120%". Il n’y a pas besoin d’être sorti de Polytechnique pour comprendre que le surplus est de 40% et que, rapporté au médicament qu’il prenait jusqu’alors, sa concentration sanguine aura augmenté, en proportion, de 40/80, soit une augmentation de 50% ! [12]. Il va de soi - du moins : il devrait aller de soi - que, notamment avec les produits ayant une "marge thérapeutique étroite" (comme les antiépileptiques), une telle variabilité de concentration fait courir des risques considérables au patient concerné.
Mais l’aveuglement des autorités va encore plus loin. Car pour peu onéreuses qu’elles soient par rapport à un développement pharmaceutique "normal" et nonobstant leurs limites qui viennent d’être démontrées même lorsqu’elles sont bien menées, ces études de bioéquivalence font elles-mêmes l’objet d’un trafic éminemment suspect, avec notamment une forte tendance - elles aussi - à la délocalisation dans des pays où, notoirement, la réglementation des essais cliniques relève du voeu pieux. Ainsi et selon l’un de mes informateurs, deux centres indiens spécialisés dans la réalisation de telles études auraient été momentanément interdits en 2005, en raison de leurs pratiques frauduleuses : s’est-on seulement intéressé rétrospectivement aux génériques qui avaient été autorisés sur la base d’une étude réalisée dans ces centres ?
Le vrai problème, c’est que seule une proportion infime des études de bioéquivalence fait l’objet d’une inspection : un indicateur intéressant de la crédibilité des autorités sanitaires dans leur zèle promotionnel à l’endroit des génériques serait de leur demander le nombre total de génériques qui ont été autorisés dans notre pays depuis disons 15 ans et, relativement à ce nombre (que je soupçonne assez considérable), la proportion des études de bioéquivalence qui ont fait l’objet d’une inspection effective. Dans l’attente de cette comparaison instructive [13], il faudrait beaucoup de naïveté pour croire en la similarité des génériques et des médicaments princeps [14] [15].
Les génériques : un cas d’école
Régression préoccupante saluée comme un progrès par tous les pourfendeurs de Big Pharma dont l’assentiment jobard conforte les autorités dans des mesures d’incitation de plus en plus contraignantes, l’avènement des génériques mérite au contraire d’être dénoncé au travers de la grille d’analyse découlant des constats précédents. Car s’il est classique de stigmatiser l’industrie pharmaceutique (et leurs autorités de tutelle) pour les prix exorbitants de leurs pseudo-innovations censément justifiés par un coût de recherche nettement surévalué [10], force est de constater qu’en pharmacie, la fabrication de génériques représente, à l’autre extrême, un moyen facile de faire de l’argent à bas coût, en utilisant - avec la scandaleuse connivence des agences sanitaires - la santé publique comme variable d’ajustement [11].
Si elle en est venue aujourd’hui à concerner à peu près tous les médicaments, il faut bien constater, en effet, que cette dégradation accélérée de la qualité pharmaceutique a été fortement encouragée par la mode des génériques qui ne connaît quasiment d’autre règle que la réduction des coûts - coûte que coûte, si j’ose dire. Et pour maximiser cette réduction (partant, le profit du génériqueur), la délocalisation est une stratégie clé. Le médicament aura, par exemple, été fabriqué au Canada, sur un principe actif produit en Inde à partir de matières premières venus de Chine, l’autorisation de mise sur le marché ayant été finalement octroyée sur la base d’une petite étude de bioéquivalence (cf. plus bas) réalisée en Pologne : ce n’est pas un circuit aussi étourdissant qui empêchera les autorités de rançonner les citoyens français via un remboursement financé par la Sécurité sociale...
A elle seule, cette "étude de bioéquivalence" suffit à caractériser et la mauvaise foi des autorités, et leur criminelle inconscience. Pour faire simple, il s’avère que l’essentiel qui conditionne l’autorisation de mise sur le marché d’un générique est une petite étude généralement réalisée chez une vingtaine de patients qui permet de montrer que les taux sanguins obtenus avec la copie sont "à peu près" les mêmes que ceux obtenus avec le médicament copié (princeps). Par "à peu près", la réglementation entend que la concentration maximale obtenue avec le générique se situe dans une fourchette de ±20% par rapport au princeps (soit, en d’autres termes, dans une zone comprise entre 80% et 120% relativement aux valeurs obtenues avec le médicament princeps).
Imaginons un patient qui reçoit un "générique-80%" et qui ajuste sa posologie avec ce médicament ; imaginons maintenant que lors du renouvellement, il lui soit délivré un "générique-120%". Il n’y a pas besoin d’être sorti de Polytechnique pour comprendre que le surplus est de 40% et que, rapporté au médicament qu’il prenait jusqu’alors, sa concentration sanguine aura augmenté, en proportion, de 40/80, soit une augmentation de 50% ! [12]. Il va de soi - du moins : il devrait aller de soi - que, notamment avec les produits ayant une "marge thérapeutique étroite" (comme les antiépileptiques), une telle variabilité de concentration fait courir des risques considérables au patient concerné.
Mais l’aveuglement des autorités va encore plus loin. Car pour peu onéreuses qu’elles soient par rapport à un développement pharmaceutique "normal" et nonobstant leurs limites qui viennent d’être démontrées même lorsqu’elles sont bien menées, ces études de bioéquivalence font elles-mêmes l’objet d’un trafic éminemment suspect, avec notamment une forte tendance - elles aussi - à la délocalisation dans des pays où, notoirement, la réglementation des essais cliniques relève du voeu pieux. Ainsi et selon l’un de mes informateurs, deux centres indiens spécialisés dans la réalisation de telles études auraient été momentanément interdits en 2005, en raison de leurs pratiques frauduleuses : s’est-on seulement intéressé rétrospectivement aux génériques qui avaient été autorisés sur la base d’une étude réalisée dans ces centres ?
Le vrai problème, c’est que seule une proportion infime des études de bioéquivalence fait l’objet d’une inspection : un indicateur intéressant de la crédibilité des autorités sanitaires dans leur zèle promotionnel à l’endroit des génériques serait de leur demander le nombre total de génériques qui ont été autorisés dans notre pays depuis disons 15 ans et, relativement à ce nombre (que je soupçonne assez considérable), la proportion des études de bioéquivalence qui ont fait l’objet d’une inspection effective. Dans l’attente de cette comparaison instructive [13], il faudrait beaucoup de naïveté pour croire en la similarité des génériques et des médicaments princeps [14] [15].
Re: Médicaments génériques
Bonjour à tous et toutes,
J'ai travaillé pendant 18 ans au sein du service marketing d'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiales et mon expérience de cette industrie du médicament est parfaitement décrite par la revue Prescrire qui est entièrement indépendante de l'industrie pharmaceutique et de l'état français.
Je vous conseille d'aller sur leur site d'ailleurs voici le lien que vous pouvez copier-coller dans votre barre d'adresse de votre navigateur internet et écouter les conférences enregistrer de ce début d'année.
http://www.prescrire.org/Fr/109/440/48258/2312/ReportDetails.aspx
Après avoir écouté et lu sur ce site indépendant médical, votre vision du médicament ne sera plus la même pour vôtre santé.
Cordialement.
J'ai travaillé pendant 18 ans au sein du service marketing d'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiales et mon expérience de cette industrie du médicament est parfaitement décrite par la revue Prescrire qui est entièrement indépendante de l'industrie pharmaceutique et de l'état français.
Je vous conseille d'aller sur leur site d'ailleurs voici le lien que vous pouvez copier-coller dans votre barre d'adresse de votre navigateur internet et écouter les conférences enregistrer de ce début d'année.
http://www.prescrire.org/Fr/109/440/48258/2312/ReportDetails.aspx
Après avoir écouté et lu sur ce site indépendant médical, votre vision du médicament ne sera plus la même pour vôtre santé.
Cordialement.
Re: Médicaments génériques
Hier j’ai regardé l’émission les infiltrés sur France 2 pour avoir des informations complémentaires sur les génériques.
Ce que j’en ai ressentit :
Il y a des marges arrière par l’intermédiaire de société écran entre les labos et les pharmaciens. En gros les pharmaciens toucheraient 3000 € pour mettre des publicités dans les officines s’ils vendent des génériques. (Marge supplémentaire de 60%)
Ils auraient des boites de médicaments génériques gratuites (1 boites sur 10). Boite qu’ils vendent et se font rembourser par la Sécu.
Donc les pharmaciens seraient complice des labos aux frais de la sécu. Les patients passent en second plan.
J’espère que les responsables de la sécu ont vu cette émission sinon il faut qu’ils voient une rediffusion.
Ce que j’en ai ressentit :
Il y a des marges arrière par l’intermédiaire de société écran entre les labos et les pharmaciens. En gros les pharmaciens toucheraient 3000 € pour mettre des publicités dans les officines s’ils vendent des génériques. (Marge supplémentaire de 60%)
Ils auraient des boites de médicaments génériques gratuites (1 boites sur 10). Boite qu’ils vendent et se font rembourser par la Sécu.
Donc les pharmaciens seraient complice des labos aux frais de la sécu. Les patients passent en second plan.
J’espère que les responsables de la sécu ont vu cette émission sinon il faut qu’ils voient une rediffusion.
Re: Médicaments génériques
Le médicament est une "industrie" et comme dans tous les secteurs nous y trouvons des gens sérieux mais aussi des gens un peu moins sérieux.
L’appât du gain comme dans l'affaire de la viande de bœuf remplacé par de la viande de cheval nous démontre que les lois, règles et obligations sont facilement contournées. Alors soyons vigilants sur ces médicaments moins chers, car si un traitement nécessite 6 comprimés pourquoi nous vendre une boite de 10 comprimés. Les pharmaciens font tout pour empêcher l'arrivée de la grande distribution (et internet) ils ont pourtant une opportunité à saisir et faire leur métier de "préparateur" sans aller jusqu'à revenir à la préparation complète, mais préparer des conditionnements qui correspondent aux durées des traitements. Les boites à pharmacies des particuliers regorgent de boites entamées qui finiront à la poubelle.
Peut être pour cela que les assurances privées aux USA veillent à éviter le gaspillage de leurs finances et que ces médicaments sont distribués presque à la pièce.
L’appât du gain comme dans l'affaire de la viande de bœuf remplacé par de la viande de cheval nous démontre que les lois, règles et obligations sont facilement contournées. Alors soyons vigilants sur ces médicaments moins chers, car si un traitement nécessite 6 comprimés pourquoi nous vendre une boite de 10 comprimés. Les pharmaciens font tout pour empêcher l'arrivée de la grande distribution (et internet) ils ont pourtant une opportunité à saisir et faire leur métier de "préparateur" sans aller jusqu'à revenir à la préparation complète, mais préparer des conditionnements qui correspondent aux durées des traitements. Les boites à pharmacies des particuliers regorgent de boites entamées qui finiront à la poubelle.
Peut être pour cela que les assurances privées aux USA veillent à éviter le gaspillage de leurs finances et que ces médicaments sont distribués presque à la pièce.
-
frederic-hemar
- Consom'acteur *

- Messages : 1
- Enregistré le : 28 févr. 2013, 16:36
Re: Médicaments génériques Viagra
Il y a un sujet que je ne vois jamais abordé c'est celui des génériques non remboursés.
Le viagra a été génériqué dès 2011, à ce jour plus de 12 labos ont reçu l'agrément et figurent sur le répertoire des médicaments de l'agence nationale du médicament : Teva, Sandoz, Biogaran, Crister,...( il suffit d'entrer le nom de la molécule " sildénafil" ds le répertoire pour lister les labos et les spécialités autorisés ).
Or à ce jour la seule spécialité commercialisée demeure Viagra de Pfizer.
Pourquoi les autres labos ne commercialisent ils pas en France ?
Peut on acheter ( sur prescription ) du Sildénafil Sandoz en Suisse et repasser la frontière à bon droit ?
Merci pour vos lumières
Crdlt
Le viagra a été génériqué dès 2011, à ce jour plus de 12 labos ont reçu l'agrément et figurent sur le répertoire des médicaments de l'agence nationale du médicament : Teva, Sandoz, Biogaran, Crister,...( il suffit d'entrer le nom de la molécule " sildénafil" ds le répertoire pour lister les labos et les spécialités autorisés ).
Or à ce jour la seule spécialité commercialisée demeure Viagra de Pfizer.
Pourquoi les autres labos ne commercialisent ils pas en France ?
Peut on acheter ( sur prescription ) du Sildénafil Sandoz en Suisse et repasser la frontière à bon droit ?
Merci pour vos lumières
Crdlt
-
- A lire aussi
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 0 Réponses
- 1735 Vues
-
Dernier message par luciole83
Voir le dernier message
08 mars 2024, 17:30
-
- 9 Réponses
- 5339 Vues
-
Dernier message par xylo
Voir le dernier message
26 juil. 2025, 15:17
-
- 1 Réponses
- 2379 Vues
-
Dernier message par Saufmarcel
Voir le dernier message
02 févr. 2022, 18:00
-
- 0 Réponses
- 3325 Vues
-
Dernier message par vrankinou
Voir le dernier message
17 juin 2020, 20:20
-
- 1 Réponses
- 3951 Vues
-
Dernier message par Nico37
Voir le dernier message
24 août 2018, 19:08
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité